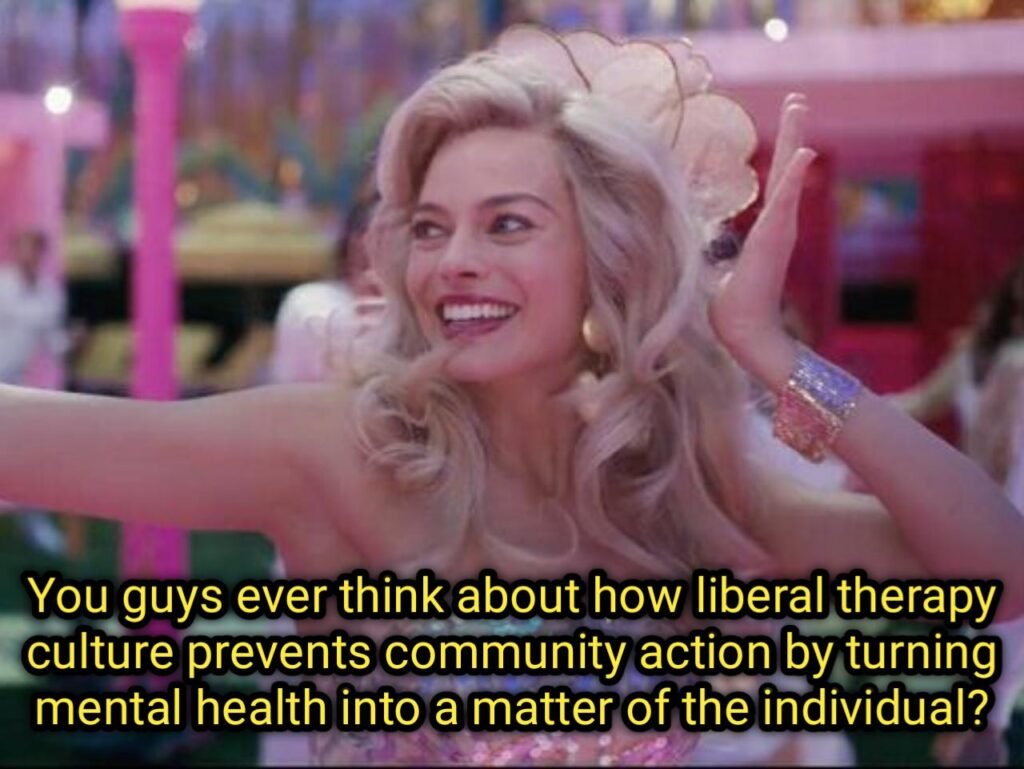
Traduction: “Vous avez déjà réfléchi à la façon dont la culture de la thérapie libérale empêche l’action collective en transformant la santé mentale en une question purement individuelle ?” Image: Reddit
La santé mentale est souvent abordée comme une question individuelle, un problème personnel à régler par l’introspection et les soins psychologiques.
Pourtant, elle est indissociable des structures politiques, économiques et sociales qui façonnent nos vies.
La souffrance psychique n’est pas seulement une expérience interne ; elle est en grande partie une réaction à des conditions d’existence injustes, inégalitaires et oppressives.
Dans une société où la flexibilité et l’adaptation sont devenues des injonctions, la santé mentale est souvent abordée sous l’angle de la responsabilisation personnelle : il faudrait apprendre à “gérer son stress”, à “renforcer sa résilience”, à “travailler sur soi”.
Mais jusqu’à quel point cet appel à l’adaptation ne constitue-t-il pas une forme d’accommodation à un monde fondamentalement dysfonctionnel ?
Dissonance cognitive et hypernormalisation : une santé mentale sous pression
La dissonance cognitive, concept introduit par Leon Festinger en 1957, désigne la tension, le malaise interne ressenti lorsqu’un individu est confronté à des réalités, des croyances ou des valeurs contradictoires. Un exemple peut être le malaise que peuvent ressentir certains consommateurs de viande en visionnant des images de mise à mort de bétail, ou de séparation d’un veau et de sa mère.
Dans nos sociétés contemporaines, cette dissonance est exacerbée par des structures économiques et politiques qui imposent des normes de vie contraires aux besoins humains fondamentaux.
Ce phénomène se retrouve notamment dans la façon dont le capitalisme impose un mode de vie hyper-productif, tout en promouvant un idéal de bien-être et d’épanouissement personnel, créant une double contrainte : il faut être performant, rentable et compétitif, tout en étant en quête d’équilibre et de sérénité. Cette injonction paradoxale est au cœur des souffrances psychiques modernes.
C’est dans ce contexte que le concept d’hypernormalisation, développé par Alexeï Iourtchak dans ses études sur l’URSS et popularisé par Adam Curtis dans son documentaire HyperNormalisation (2016), prends son sens: il décrit comment les élites politiques et économiques créent une réalité simplifiée et artificielle pour maintenir un contrôle sur la population, alors même que tout le monde sait que ce système est absurde ou mensonger.
Ainsi, les individus perçoivent instinctivement que le système est dysfonctionnel et artificiel, mais continuent de l’alimenter, malgré un malaise croissant, faute d’alternatives perçues.
Dans le domaine de la santé mentale, cela se traduit par une pression constante sur les individus pour s’adapter à un monde qui ne fonctionne pas, plutôt que de remettre en question les structures qui génèrent la souffrance. Comme l’explique la psychiatre palestinienne Samah Jabr, la souffrance psychique des peuples opprimés ne peut être comprise uniquement en termes cliniques, mais doit être envisagée comme une réponse rationnelle à un environnement injuste (dans: Beyond the Frontlines: Tales of Resistance and Resilience in Palestine).
Ainsi, lorsqu’une personne ressent un mal-être lié à des conditions de travail précaires, au coût exorbitant du logement ou à un système économique inégalitaire, la réponse dominante ne sera pas de questionner ces structures, mais de l’inviter à développer sa “résilience”.
On individualise alors une souffrance pourtant politique et systémique.
Capitalisme, uniformisation et marginalisation de la diversité humaine : une fabrique à handicaps artificiels
Le capitalisme contemporain repose sur un principe fondamental : l’optimisation de la productivité et de la consommation de masse. Pour atteindre cet objectif, il impose des normes de vie standardisées, façonnées autour d’un idéal de rentabilité et de conformité.
Tout ce qui échappe à cette norme devient un problème à corriger, une “déviance” à médicaliser ou à marginaliser.
C’est ainsi que des différences pourtant naturelles et nécessaires au bon fonctionnement des sociétés humaines deviennent des handicaps artificiels. Par exemple :
• La neurodiversité : Le modèle capitaliste valorise une concentration linéaire et une capacité à fonctionner selon des rythmes rigides (8h-17h, productivité continue). Les personnes autistes, TDAH ou autrement neurodivergentes, dont les besoins et modes de fonctionnement sont différents mais souvent porteurs de créativité et d’innovation, sont considérées comme “inadaptées” au marché du travail tel qu’il est conçu. Pourtant, dans d’autres modèles de société, ces mêmes caractéristiques seraient valorisées, par et pour ce qu’elles apportent de complémentaire, de nécéssaire.
• Les gauchers : Historiquement, ils représentent environ 10 à 13 % de la population, un pourcentage constant à travers les époques. Si cette proportion demeure stable, c’est qu’elle remplit une fonction essentielle dans la diversité humaine. Mais dans les sociétés industrialisées, tout a été conçu pour les droitiers : des outils aux postes de travail, les forçant ainsi à une adaptation constante qui crée des désavantages artificiels. Dans certaines traditions, comme chez les Catholiques, être gaucher a été associé à des connotations négatives, et l’idée que la gaucherie était “contre-nature” ou maléfique (« la main du diable ») a mené à des persécutions, des discriminations et des pratiques de correction violentes.
• Les personnes queer : Les structures capitalistes et patriarcales ont longtemps cherché à invisibiliser et pathologiser les identités de genre et orientations sexuelles qui ne rentraient pas dans le moule hétéronormatif. Comme le note Ochy Curiel, anthropologue féministe décoloniale, l’imposition de la binarité de genre dans les sociétés occidentales s’est accompagnée d’un contrôle du corps et des rôles sociaux, renforcé par des institutions religieuses et économiques (dans: La Nación Heterosexual). Pourtant, les personnes queer ont été, dans les civilisations anciennes, à travers le monde, partie intégrante de la société.
• Le sommeil et les rythmes biologiques : Le capitalisme impose un rythme de vie artificiel et standardisé, où tout le monde doit dormir aux mêmes heures et travailler selon un modèle figé. Or, historiquement et biologiquement, toutes les sociétés humaines ont toujours compté sur des individus aux cycles de sommeil décalés : certains veillaient tard, d’autres se levaient à l’aube, assurant ainsi une sécurité collective. L’exigence actuelle d’un sommeil uniforme (8h d’affilée la nuit) ne tient aucun compte de cette diversité naturelle et génère des troubles du sommeil artificiels, médicalisés et traités comme des “dysfonctionnements” alors qu’ils sont en partie une réaction à une norme inadaptée.
Une société qui exclut au lieu de s’adapter
Ce que montre cette logique, c’est que le problème n’est pas l’individu qui ne rentre pas dans le moule, mais le moule lui-même qui est mal conçu.
Dans une société communautaire et diversifiée, chaque individu trouve une place où ses spécificités sont valorisées. À l’inverse, une société standardisée crée des exclus, non pas parce qu’ils sont “anormaux”, mais parce que le modèle dominant ne laisse pas de place aux différences.
C’est une réflexion que l’on retrouve dans les études critiques du handicap (Critical Disability Studies), qui affirment que le handicap n’est pas une déficience individuelle mais une construction sociale : un fauteuil roulant n’est pas un problème si la ville est conçue pour être accessible ; un autiste non verbal n’est pas un “handicapé” si le monde valorise d’autres formes de communication.
Comme l’écrit Sunaura Taylor, militante et chercheuse en études du handicap et féminisme intersectionnel :
“Le handicap est une oppression issue de la manière dont nous organisons la société, pas de la biologie des individus.” (dans: Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation).
Cette perspective remet en cause la psychiatrisation et la médicalisation forcée de la différence: il ne s’agit pas de “réparer” des individus jugés déviants, mais bien d’adapter la société pour qu’elle reflète réellement la diversité humaine.
Thérapie “blanche”, colonisation du savoir et uniformisation des pratiques de soin
Les modèles thérapeutiques dominants en Occident reposent principalement sur des approches issues de la psychanalyse, des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et des neurosciences appliquées à la psychopathologie. Ces modèles, développés dans un cadre culturel, historique et politique précis — celui des sociétés européennes et nord-américaines modernes — sont souvent présentés comme universels, alors qu’ils ne le sont pas.
La thérapie “blanche” impose une vision de la souffrance psychique qui s’inscrit dans une épistémologie occidentale individualiste. L’un des problèmes majeurs de cette approche est qu’elle dissocie l’individu de son contexte politique, social et historique, en faisant reposer sur lui seul la responsabilité de son bien-être.
L’anthropologue et psychiatre Roberto Beneduce, spécialiste de l’ethnopsychiatrie et de la souffrance psychique des personnes migrantes, critique cette approche :
“L’idée selon laquelle la souffrance psychique est strictement individuelle est une construction eurocentrée. Dans de nombreuses cultures, elle est avant tout une expérience collective, où la guérison implique des liens avec l’ancestralité, la communauté et l’environnement.” (dans: Frantz Fanon, psychiatre de la décolonisation).
Cette critique rejoint les travaux de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais et militant anticolonial, qui dénonçait déjà en 1961 dans Les Damnés de la Terre la manière dont la psychiatrie coloniale pathologisait la révolte des peuples colonisés. Il expliquait que le racisme et la domination systémique sont eux-mêmes des producteurs de souffrance psychique, et que vouloir les soigner sans remettre en cause les structures de domination revenait à réadapter les individus à leur oppression plutôt qu’à leur permettre de la combattre.
Ironiquement, alors que la psychologie et la psychiatrie occidentales ont longtemps rejeté les approches traditionnelles et communautaires des soins psychiques (rituels, pratiques corporelles, médecines indigènes, etc.), on assiste aujourd’hui à un phénomène d’appropriation culturelle dans le domaine du bien-être.
Le yoga, la méditation, le qi gong : ces pratiques spirituelles asiatiques, profondément ancrées dans des systèmes de pensée holistiques, sont aujourd’hui réduites à de simples outils de “gestion du stress” dans les thérapies occidentales, souvent dépolitisées et vidées de leur sens originel.
Les thérapies psychédéliques, ou des substances comme l’ayahuasca, ou la psilocybine, utilisées dans des contextes rituels en Amazonie depuis des siècles, font l’objet d’un engouement en Occident pour le traitement du PTSD et de la dépression — mais souvent sans reconnaissance des savoirs indigènes et sans prise en compte de leur ancrage culturel et spirituel.
Comme le souligne Bayo Akomolafe, philosophe nigérian et spécialiste des épistémologies décoloniales :
“L’Occident extrait les pratiques spirituelles des peuples indigènes et les transforme en biens de consommation, sans jamais remettre en cause les structures coloniales qui ont cherché à les détruire en premier lieu.” (dans: These Wilds Beyond Our Fences).
Individualisme vs besoin de communauté : La solitude comme symptôme politique
Les sociétés occidentales contemporaines sont profondément individualistes. L’accent mis sur la performance individuelle, l’autonomie et l’indépendance économique crée une vision du bien-être où chacun est responsable de sa propre réussite et de son propre équilibre psychologique.
En conséquence, les souffrances psychiques sont souvent pathologisées comme des problèmes personnels, alors qu’elles sont en grande partie des réponses rationnelles à des conditions sociales hostiles :
L’isolement social n’est pas un “défaut de caractère”, mais une conséquence d’un monde qui détruit les liens communautaires.
Le burn-out n’est pas une faiblesse individuelle, mais le résultat d’un modèle économique qui surexploite les travailleurs.
L’anxiété face à l’avenir n’est pas un “trouble mental”, mais une réaction lucide face à l’effondrement écologique, aux inégalités et à la précarisation du travail.
Dans un contexte où les communautés traditionnelles ont été dissoutes par l’urbanisation, la mobilité du travail et l’économie de marché, la gestion des souffrances psychiques est de plus en plus privatisée. Ce phénomène est décrit par la sociologue Eva Illouz (Les marchandises émotionnelles) qui montre comment le capitalisme a transformé nos émotions et nos relations en produits de consommation :
“L’Occident a progressivement remplacé les liens communautaires par des solutions individualisées et marchandes. La solitude, autrefois atténuée par la famille élargie et le voisinage, est aujourd’hui “soignée” par des thérapies, des applications de bien-être et des industries du développement personnel.”
L’individualisme occidental se reflète aussi dans l’approche dominante en psychologie clinique et en thérapie. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), très répandue, vise à modifier les pensées et comportements de l’individu, sans forcément prendre en compte l’environnement systémique et politique dans lequel il évolue.
Contrairement à cette approche individualiste, de nombreuses cultures placent la guérison dans un cadre collectif. Dans certaines sociétés africaines, sud-américaines ou asiatiques, le bien-être psychologique est indissociable de la famille, du groupe et des rituels communautaires.
La “cura” collective en Amérique latine : Dans les traditions afro-brésiliennes et indigènes, la guérison passe par des pratiques spirituelles et des interactions sociales renforcées, plutôt que par une introspection purement individuelle.
Les cercles de parole dans les cultures autochtones : Plutôt que de s’isoler avec un thérapeute, les individus partagent leurs souffrances dans des groupes, où le soutien mutuel est considéré comme fondamental pour la reconstruction psychique.
Cette logique s’oppose à l’injonction occidentale à “se débrouiller seul”, qui finit souvent par renforcer la souffrance au lieu de la soulager. Comme l’explique la psychologue Sunita Reddy, spécialiste de la santé mentale dans les communautés indiennes :
“Dans de nombreuses sociétés non occidentales, le mal-être est d’abord vu comme une question collective. Soigner l’individu sans restaurer les liens avec la communauté revient à traiter un symptôme sans s’attaquer à la cause.” (dans: Community Healing in India: Indigenous Practices and Mental Well-being).
En Occident, certains mouvements commencent à intégrer ces pratiques communautaires dans le soin psychologique. Par exemple, les thérapies basées sur le pair-accompagnement (où d’anciens patients formés aident de nouvelles personnes en souffrance) sont une tentative de recréer du lien social et du soutien mutuel dans un cadre de soin.
Les cycles de domination et la reproduction des oppressions : de la sphère intime aux systèmes globaux
L’un des aspects les plus méconnus du lien entre santé mentale et politique est la façon dont les systèmes de domination se reproduisent et s’entrelacent à plusieurs niveaux : familial, sociétal et mondial. L’oppression n’est pas un phénomène isolé ; elle est transmise de génération en génération et se réplique à différentes échelles.
Dans Le Berceau des dominations, l’anthropologue Dorothée Dussy démontre comment l’inceste, loin d’être une simple transgression individuelle, fonctionne comme un système structurant d’apprentissage de la domination. Elle explique que l’inceste est une forme d’initiation à la soumission, qui enseigne aux enfants que leur corps n’est pas leur propriété, qu’ils ne peuvent pas fixer de limites et que leur volonté peut être écrasée par des figures d’autorité. Ce conditionnement se retrouve ensuite dans d’autres formes d’oppression sociale : sexisme, racisme, exploitation économique.
Ce que révèle Dussy, c’est que la famille est le premier espace où s’exerce la domination, un modèle qui est ensuite reproduit dans la société. Ce n’est pas un hasard si les régimes totalitaires, les systèmes d’exploitation économique et les hiérarchies oppressives se structurent sur les mêmes logiques d’abus de pouvoir et de silenciation des victimes.
L’enfant : la personne la plus maltraitée au monde
L’enfance est une période où l’individu est entièrement vulnérable aux structures de pouvoir. Comme l’explique la réalisatrice et autrice Marion Cuerq dans son documentaire Même qu’on naît imbattables !, les enfants sont la population la plus maltraitée à travers toutes les intersections de discriminations. Ils n’ont ni autonomie, ni droit réel à la protection, ni moyens de défendre leur intégrité physique et psychique.
Les violences éducatives ordinaires (VEO) – coups, humiliations, punitions injustifiées – sont des pratiques si normalisées qu’elles sont rarement reconnues comme des formes de maltraitance. Pourtant, elles constituent une première école de la violence, où les enfants apprennent qu’ils doivent obéir sans discuter, encaisser la douleur et accepter que les figures d’autorité aient un droit absolu sur eux.
Ces traumatismes précoces façonnent des adultes fragilisés, plus enclins à reproduire des schémas de soumission ou de violence. Ce qui est infligé aux enfants sert de laboratoire pour les formes d’oppression à plus grande échelle. Un enfant à qui l’on apprend qu’il doit supporter des injustices sans broncher deviendra un adulte plus malléable, plus facile à exploiter dans un système économique inégalitaire, ou plus enclin à accepter un régime autoritaire.
Le trauma infantile et la perpétuation des structures de pouvoir
Les enfants victimes de maltraitance développent souvent des mécanismes de survie, comme la dissociation, la soumission à l’autorité ou la difficulté à fixer des limites. Ces mécanismes, adaptatifs dans l’enfance, deviennent ensuite des entraves à l’émancipation une fois adultes.
De nombreuses études en psychologie du trauma montrent que les individus ayant subi des traumatismes infantiles non résolus sont plus enclins à se retrouver dans des relations abusives, à accepter des conditions de travail toxiques et à intérioriser des systèmes de domination.
Ainsi, au-delà du cadre familial, les violences faites aux enfants façonnent les sociétés : elles produisent des adultes plus vulnérables, plus enclins à accepter la souffrance et la subordination, et donc plus faciles à exploiter dans des systèmes injustes. La santé mentale n’est donc pas qu’une question de bien-être personnel, elle est un enjeu politique de résistance et de transformation sociale.
L’accès aux soins : une barrière sociale et économique
Si la souffrance psychique est systémique, l’accès aux soins est lui aussi profondément inégalitaire. Dans de nombreux pays, l’offre de soins en santé mentale est segmentée entre un secteur public sous-financé, aux délais d’attente interminables, et un secteur privé onéreux, inaccessible à une grande partie de la population. Cette division renforce l’injustice sociale, où seuls ceux ayant les moyens financiers peuvent bénéficier d’un accompagnement adéquat.
Comme le souligne China Mills dans Decolonizing Global Mental Health, la médicalisation de la souffrance dans le modèle occidental repose sur une approche individualiste qui invisibilise les conditions de vie et les déterminants sociaux de la santé mentale. Le coût des soins devient une barrière structurelle, excluant les plus précaires et marginalisant davantage ceux qui subissent déjà des oppressions multiples.
L’accessibilité aux soins est aussi une question de reconnaissance culturelle. Les populations migrantes ou issues de la majorité globale, en plus des obstacles économiques, rencontrent des difficultés supplémentaires pour accéder à des soins adaptés à leurs réalités. De nombreux modèles thérapeutiques restent centrés sur une vision occidentale, blanche et individualiste, ignorant les approches collectives, spirituelles et communautaires qui peuvent être mieux adaptées à certains contextes.
En conséquence, l’accès aux soins en santé mentale n’est pas seulement une question médicale, mais une question de justice sociale. Une véritable transformation du système nécessiterait de rendre les soins accessibles financièrement, culturellement et structurellement, en reconnaissant la diversité des besoins et des pratiques de soin à travers les sociétés.
Conclusion
Si les modèles dominants tendent à la réduire à une simple question de bien-être personnel, occultant ainsi les réalités sociales, économiques et historiques qui façonnent la souffrance psychique, la santé mentale ne saurait être dissociée des structures de pouvoir qui organisent nos sociétés.
Le capitalisme impose des normes de vie qui marginalisent les différences, considérées comme des “anomalies” à corriger plutôt que comme des expressions naturelles de la diversité humaine. La psychiatrisation de ces différences participe à une violence épi-systémique, dans laquelle seuls les savoirs occidentaux sont légitimés, tandis que les pratiques de soin issues d’autres traditions sont marginalisées ou récupérées à des fins de consommation de masse.
Les structures de domination s’imbriquent à plusieurs niveaux : dans la famille, à travers les abus, les violences « éducatives », et l’apprentissage de la soumission ; dans la société, via l’exploitation économique et la marginalisation des voix dissidentes ; à l’échelle mondiale, par la perpétuation des hiérarchies coloniales et capitalistes. Chaque échelle alimente l’autre, formant un cycle où les traumatismes passés continuent de structurer les oppressions présentes.
De plus, l’inégalité d’accès aux soins renforce ces dynamiques d’exclusion et d’invisibilisation. Un système de santé qui repose sur des barrières économiques et culturelles reproduit les hiérarchies existantes et empêche les plus vulnérables d’accéder à un soutien adapté. Transformer notre approche de la santé mentale ne consiste donc pas seulement à mieux soigner les individus, mais à réinventer un système où le soin est un droit et non un privilège.
Comme l’écrivait Frantz Fanon, “chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.”
La santé mentale ne peut se résumer à une gestion individuelle de la détresse ; loin d’être un simple enjeu clinique, elle est un acte de résistance, une quête de justice et de réappropriation de nos existences face aux structures qui nous oppriment.
Sources:
Akomolafe, B. (2017). These Wilds Beyond Our Fences: Letters to My Daughter on Humanity’s Search for Home. North Atlantic Books.
Beneduce, R. (2016). Frantz Fanon, psychiatre de la décolonisation. La Découverte.
Boumediene, S. (2016). La colonisation du savoir : Une histoire des plantes médicinales du ‘Nouveau Monde’ (1492-1750). Éditions des Mondes à Faire.
Cuerq, M. (2017). Même qu’on naît imbattables ! [Documentaire].
Curtis, A. (2016). HyperNormalisation [Documentaire]. BBC.
Curiel, O. (2013). La Nación Heterosexual: Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Ediciones Corte y Confección.
Dussy, D. (2013). Le berceau des dominations: Anthropologie de l’inceste. La Découverte.
Fanon, F. (1961). Les Damnés de la Terre. François Maspero.
Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
Illouz, E. (2019). Les marchandises émotionnelles: L’authenticité au temps du capitalisme. Seuil.
Iourtchak, A. (2006). Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton University Press.
Jabr, S. (2017). Beyond the Frontlines: Tales of Resistance and Resilience in Palestine. Just World Books.
Mills, C. (2014). Decolonizing Global Mental Health: The Psychiatrization of the Majority World. Routledge.
Reddy, S. (2019). Community Healing in India: Indigenous Practices and Mental Well-being. Oxford University Press.
Taylor, S. (2017). Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation. The New Press.
Van der Kolk, B. (2014). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Viking.
Article écrit par un humain (Lola Sliwinski), relecture à l’aide de l’IA.
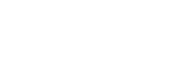
Vraiment très bien écrit et documenté !
Terriblement vrai, le constat n’est pas amiable : tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains sales souvent ensanglantées de politicard.e.s pourri.e.s (et le mot est faible, mais chez eux il y a des rince-doigts et du « sent bon »…) partouzant à nos frais les institutions dans les ors des palais…
Tableau très sombre de cette société capitaliste kollabo colonialiste criminelle (pléonasme) bâtie sur la mémoire courte et les dents longues, l’argent sale, l’injustice sociale, le racisme, la domination systémique, l’outrage permanent à l’Intelligence Publique grâce à la Propagandastaffel (en allemand « escadron de propagande ») à la télévision boîte à cons, à la radio, dans les journaux à emballer les ordures ménagères, l’obscénité, et qui exclut par tous les moyens : guerres, ultra violences policières, corruption, carnage social, carnage sanitaire organisés, et j’en passe… Un car de police aussi… Alors le quotidien devient fatal…
Frères humains synthétisés
Vivants par groupes surcompressés
Frères normaux d’acier brossé
Technocrates pour la pesée
Produisez votre mort en branches
En transistors en impédances
Et choisissez vos coloris
Pour le week-end et pour l’ennui
Encastrez-vous dans le présent
Bétonnez-vous de l’en dedans
Fissurez-vous de l’extérieur
On va partir vers un ailleurs
Raccourcissez vos émotions
Devenez précis attention
Tous les dangereux pessimistes
Seront soignés dans nos cliniques
Dites-moi où est le pouvoir?
Dites-moi où est le pouvoir?
Dites-moi où est le pouvoir?
Dites-moi où est le pouvoir?
©Bernard Lavilliers, « Pouvoirs »
Alors la santé mentale du Citoyen Lambda ne trouble vraiment pas la digestion des petits barons napoléoniens et autres dictateurs qui ont confisqué le pouvoir, tous les pouvoirs depuis que ce merveilleux monde capitalo masculiniste sexiste chauviniste mâle existe !
Lorsque l’Enfant paraît, il/elle est aussitôt « encadré.e », formaté.e dès son plus jeune âge afin de devenir le plus rapidement possible pour pas cher (éducation nationale au rabais, manque de moyens, manque de personnel enseignant…) un.e « bon.ne employé.e » rentrant bien comme il faut dans le moule, plus vulnérable, plus docile, plus facile à exploiter dans des systèmes injustes, plus enclin.e à accepter la souffrance et la subordination à des petits chefaillons qui puent de la gueule et des pieds, aux mains moites indiscrètes et baladeuses…
Résilience, mot très à la mode, très galvaudé depuis quelque temps…
Comme l’écrit si bien Madame Sliwinski, « la santé mentale est un acte de résistance, une quête de justice et de réappropriation de nos existences face aux structures qui nous oppriment ».
Les structures qui nous oppriment sont les ténias bons à rien prêts à tout qui se gobergent et chient sur la république, sur la démocratie à l’élysée, à matignon, à l’assemblée nationale, au sénat, au parlement européen… Eux ont choisi : dans la vie soit on travaille soit on gagne du fric…
Quand est-ce qu’on les jette ?
Un pessimiste est un optimiste qui a bien roulé sa bosse et qui a de l’expérience…
Thierry Vaganay